
Voilà un film casse-gueule par excellence, basé sur un parti unique digne d'un court-métrage d'école (huis-clos, situation simple et dramatique). Fincher s'en sort haut la main, prouvant qu'il possède un sens aigu du cadre, de la mise en espace et du rythme… ce que l'on savait déjà.
s'en sort haut la main, prouvant qu'il possède un sens aigu du cadre, de la mise en espace et du rythme… ce que l'on savait déjà.
Seulement, derrière l'exploit formaliste que représente le film, il n'y a pas grand chose… ce à quoi l'on était déjà habitué avec ses autres films.
Seven est superbe sur la forme mais les personnages ne mènent nulle part. Fight Club
est superbe sur la forme mais les personnages ne mènent nulle part. Fight Club est visuellement délirant mais la fin (le « bouclage » des personnages) est ridicule avec une thématique on ne peut plus simpliste, voir dangereuse. Panic Room,
est visuellement délirant mais la fin (le « bouclage » des personnages) est ridicule avec une thématique on ne peut plus simpliste, voir dangereuse. Panic Room, c'est la même chose en moins tendancieux, en plus « politiquement correct ».
c'est la même chose en moins tendancieux, en plus « politiquement correct ».
Ainsi est politiquement correct le sort de Forrest Whitaker, tout comme est convenue l'évolution du personnage qui apprendra pendant tout le film une seule chose : surmonter sa claustrophobie… C'est peu ! Les autres personnages sont encore plus effacés, que ce soit l'ancien mari, ou bien encore la jeune fille… Il reste heureusement les trois méchants, assez drôles, même si souvent leurs jeux de mots et leurs réactions se devinent de longues minutes à l'avance.
Il y a tout de même des scènes formidables. Le générique aérien avant la plongée dans le huis-clos est d'une grande beauté, tout comme le plan séquence qui précède l'irruption des trois hommes (même s'il est un peu trop visiblement truqué) ou encore le transtrav du plan final, sublime dans la manière dont il redonne de l'espace et de l'air aux personnages… Il faut apprendre à s'en contenter et commencer, peut-être, à se faire à l'idée que Fincher, un peu comme Besson
un peu comme Besson mais en nettement plus doué, est un metteur en scène et ne sera sans doute jamais un auteur.
mais en nettement plus doué, est un metteur en scène et ne sera sans doute jamais un auteur.
Une grande déception que ce thriller claustrophobe. Tout d'abord pour qu'un film d'angoisse fonctionne parfaitement il faut que le spectateur se prenne de sympathie pour les personnages, ce qui n'est pas le cas ici présent pour Jodie Foster et sa fille, loin s'en faut… et que le danger soit réel ce qui là aussi est loin d'être le cas avec les trois pieds nickelés qui investissent l'appartement des belles afin de trouver un magot appartenant à l’ancien propriétaire. FOREST WHITAKER ne fait que du WITAHKER alors qu'il a prouvé à de maintes occasions qu'il pouvait se surpasser.
et sa fille, loin s'en faut… et que le danger soit réel ce qui là aussi est loin d'être le cas avec les trois pieds nickelés qui investissent l'appartement des belles afin de trouver un magot appartenant à l’ancien propriétaire. FOREST WHITAKER ne fait que du WITAHKER alors qu'il a prouvé à de maintes occasions qu'il pouvait se surpasser.
A passer donc malgré des prouesses techniques magnifiques mais qui laissent de marbre comme un beau tableau sans âme.
(Bis) Ne serait-il pas intéressant de proposer, sur ce forum, l'analyse des scènes ou des séquences qui nous ont touchés dans les films que nous aimons ? (Bis)
Je propose, cette fois – comme pour le Shining de Kubrick – d'évoquer le début et la fin du Panic room
de Kubrick – d'évoquer le début et la fin du Panic room de Fincher.
de Fincher.
On a souligné qu'avec ce film, David Fincher réalise, d'abord, un exercice de style particulièrement réussi. Mais on doit ajouter qu'il crée aussi une atmosphère prenante dans la mise en place de son huis clos et, parallèlement, jette un regard caustique sur la recherche du besoin de sécurité absolue qui caractérise nombre de citoyens de son pays (humour : comment concevoir, une fois que Meg et Sarah sont enfermées dans l'abri, qu'elles puissent en sortir ?!). Il se permet même une subtile réflexion – cinématographique – sur les différences de destin selon la condition sociale à travers le jeu de l'apparence et de la réalité.
Dès le générique (sans aucun doute inspiré de celui de La Mort aux trousses d'Hitchcock), la maîtrise technique de Fincher capte notre attention. Les multiples plans « aériens » de New York – plans fixes d'abord, puis lents travellings, plongées, contre plongées et vues en perspective se succèdent et suscitent le vertige – semblent le fait d'une entité supérieure qui scrute en tous sens cette ville réduite à ses buildings, cependant que l'activité humaine, écrasée au fond de véritables puits de béton et de verre, apparaît pour ce qu'elle est, canalisée, ordonnée et dérisoire. Ce regard caméra venu d'en haut impose alors la démesure des buildings qui semblent refléter dans leurs mille et une fenêtres l'anonymat, la froideur et l'étrangeté, ne serait-ce que parce que la Cathédrale elle-même – donc la dimension spirituelle de l'homme – est filmée comme écrasée par cet environnement moderne. Une impression renforcée d'ailleurs par les mots d'un générique aux étonnantes lettres blanches en relief, comme sculptées, qui s'accrochent frontalement aux façades ou suivent la perspective des profondes rues, se reflètent dans les vitres. S'installe ainsi, d'emblée, un malaise souligné enfin par un double thème musical : l'un, comme sous-jacent, souterrain et rampant par ses notes graves, évoque une menace qui semble rôder ; quand l'autre, qui lui succède bientôt au moment où s'affiche le titre, martèle les trois coups répétés d'un drame imminent.
d'Hitchcock), la maîtrise technique de Fincher capte notre attention. Les multiples plans « aériens » de New York – plans fixes d'abord, puis lents travellings, plongées, contre plongées et vues en perspective se succèdent et suscitent le vertige – semblent le fait d'une entité supérieure qui scrute en tous sens cette ville réduite à ses buildings, cependant que l'activité humaine, écrasée au fond de véritables puits de béton et de verre, apparaît pour ce qu'elle est, canalisée, ordonnée et dérisoire. Ce regard caméra venu d'en haut impose alors la démesure des buildings qui semblent refléter dans leurs mille et une fenêtres l'anonymat, la froideur et l'étrangeté, ne serait-ce que parce que la Cathédrale elle-même – donc la dimension spirituelle de l'homme – est filmée comme écrasée par cet environnement moderne. Une impression renforcée d'ailleurs par les mots d'un générique aux étonnantes lettres blanches en relief, comme sculptées, qui s'accrochent frontalement aux façades ou suivent la perspective des profondes rues, se reflètent dans les vitres. S'installe ainsi, d'emblée, un malaise souligné enfin par un double thème musical : l'un, comme sous-jacent, souterrain et rampant par ses notes graves, évoque une menace qui semble rôder ; quand l'autre, qui lui succède bientôt au moment où s'affiche le titre, martèle les trois coups répétés d'un drame imminent.
Puis la caméra saisit un feuillage et la rangée d'arbres, qui suit, introduit la Nature dans la Ville par le biais d'un panoramique isolant un Central Park montré tel un vestige incongru, cependant qu'une voix féminine s'impose sur la musique et nous fait entrer dans le détail de la fourmilière humaine qui s'agitait, il y a peu, tout en bas. Et, précisément, cette conversation dans la rue entre deux femmes, leur marche pressée, et les reproches sur leur retard que leur adresse l'agent immobilier, sont les signes d'une société qui a perdu ses repères traditionnels : une Nature qui n'est plus qu'un décor artificiel, une vie qui s'apparente à une course, perdue d'avance, contre le temps. L'histoire peut commencer, nous savons qu'elle ne sera pas banale…
(…)
Le film s'achève, du point de vue du récit, sur le sacrifice de Burnham : voulant éviter les meurtres des deux femmes, il renonce à fuir avec les Bons dérobés. Fincher, non sans quelque grandiloquence, le filme, en contre plongée, les bras écartés tel un Christ, dont le visage montré en gros plan dit toute la détresse. Puis, Fincher lui substitue aussitôt celui de Meg, aussi émouvant. Ce parallèle entre les deux visages – et les deux destins – n'est pas sans signification et nous conduit à comparer les deux désarrois et à aller au-delà des simples apparences. Ces deux gros plans, malgré leur identité, sous-tendent bien plutôt le contraire. C'est bien Burnham qui est le personnage lumineux du film. Cet homme crucifié par sa bonté n'est-il pas précisément Celui que cherchait le regard caméra du générique dans cette ville anonyme de New York, livré à l'infidélité d'un Stephan Altman abandonnant femme et enfant, à l'affairisme immobilier d'un Evan Kurlander, à la cupidité d'un petit-fils prêt à léser les héritiers de son grand-père ? Burnham, à l'inverse, homme profondément humain et généreux, est poussé par la nécessité – payer le procès pour obtenir la garde de ses enfants – à se montrer, brièvement, malhonnête. Sa Rédemption (?!) par son sacrifice laisse un goût bien amer au spectateur et l'amène à penser que c'est bien lui le personnage central du film et que le don de soi n'est pas récompensé. La victime, au final, n'est plus celle que l'on imaginait jusqu'alors : la situation de Burnham s'est définitivement aggravée alors que celle de Meg s'est améliorée. C'est bien la différence sociale qui explique la différence de destin !
Et, en effet, après un long fondu au noir qui efface en quelque sorte le drame, se développe alors la séquence finale du film qui est à mettre en perspective avec la séquence initiale. Il s'agit du même décor urbain de New York. Mais alors que le film commençait par une marche hâtive ponctuée des reproches de Meg à sa fille, la fin nous montre la mère et la fille, étroitement réunies sur un banc public, comme apaisées par l'épreuve subie, commentant – ensemble – les annonces immobilières. Le décor initial de la rue laisse place au cadre final chaleureux d'un Central Park magnifié par les couleurs mordorées de l'automne.
Mais ce n'est là qu'une apparence : la conversation des deux femmes est si futile par rapport au destin tragique de Burnham, que nous sommes amenés à penser que Fincher manie l'ironie : décidément, dans son cinéma souvent décrié pour son formalisme, voire sa vacuité, mais dont il faut décoder les apparences, les victimes – personnages ET spectateurs – ne sont pas celles que l'on croit…
Votre analyse est pertinente et intéressante.
Ce film est avant tout un excellent thriller, qui tient en haleine de bout en bout, mais il contient aussi, comme vous le faites remarquer, un descriptif poussé et réaliste de la vie dans un pâté de maison new-yorkais, lequel nous est présenté comme une savane, ou se cotoient de dangereux prédateurs et des bêtes inoffensives qui doivent lutter pour leur survie, et se transformer elles-mêmes parfois en prédateurs, sous peine d'être dévorées tout cru. Un terrain de chasse dont l'enjeu est l'argent, lequel permet d'acquérir un statut social que l'on n'a pas, ou de conserver celui que l'on a. Un environnement hostile qui engendre chez ses habitants, névroses, complexes, troubles psychologiques divers, difficultés à communiquer, agoraphobie…
Une belle fable urbaine et moderne, racontée sur le mode d'un thriller psychologique terrifiant.
Nous sommes d'accord et ce film n'est pas "vide de sens", contrairement à ce que l'on a pu dire alors.
"Pourquoi n'avons-nous pas pensé à faire ça ?", dit Whitaker, en voyant Jodie Foster
en voyant Jodie Foster briser toutes les caméras de surveillance.
briser toutes les caméras de surveillance.
Cette réplique-justification un peu tardive, stigmatise le problème de ce film admirablement réalisé, très bien interprété, mais qui pèche trop souvent par son illogisme (pourquoi montrer si vite que Whitaker est inoffensif, au lieu de le voir évoluer ?), ou des impasses de scénario difficiles à gober. Outre la mise en scène élégante, aérienne, un peu trop chichiteuse par moments (les plans "macro" vus et revus dans Les experts)
est inoffensif, au lieu de le voir évoluer ?), ou des impasses de scénario difficiles à gober. Outre la mise en scène élégante, aérienne, un peu trop chichiteuse par moments (les plans "macro" vus et revus dans Les experts) , Panic room
, Panic room doit beaucoup à l'intensité de Jodie Foster,
doit beaucoup à l'intensité de Jodie Foster, comédienne cérébrale par excellence, qui a pourtant le talent de ne jamais trop intellectualiser ses personnages. Son jeu physique est ici la clé de voûte du film. Les trois Pieds Nickelés faisant office d'adversaires, sont vraiment trop bêtes pour inquiéter vraiment, et la fin sombre dans le grand-guignol façon Freddy,
comédienne cérébrale par excellence, qui a pourtant le talent de ne jamais trop intellectualiser ses personnages. Son jeu physique est ici la clé de voûte du film. Les trois Pieds Nickelés faisant office d'adversaires, sont vraiment trop bêtes pour inquiéter vraiment, et la fin sombre dans le grand-guignol façon Freddy,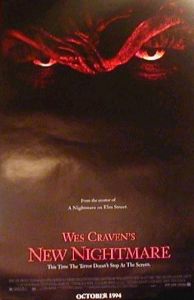 mais cela reste un bon thriller, rondement mené, et surtout très joliment filmé et monté.
mais cela reste un bon thriller, rondement mené, et surtout très joliment filmé et monté.
Réplique qui donne un bon exemple du côté limite du scénario : cette justification a posteriori est presque une inside joke, et je suis sûr que plusieurs spectateurs ont dû rire dans la salle. Dans tout problème de chambre close, il y a forcément un truc ! Ça reste un bon suspense où Jodie Foster et Forest Whitaker
et Forest Whitaker sont brillants. Les séquences à l'intérieur de la chambre forte sont saisissantes, et l'excellente bande son très dure pour les nerfs !
sont brillants. Les séquences à l'intérieur de la chambre forte sont saisissantes, et l'excellente bande son très dure pour les nerfs !
bonjour,
je trouve immoral qu'ils laissent la personne qui leurs a sauver la vie se faire arrêter !
Ce n'est pas une fin "morale", mais réaliste.
Eh oui… si on veut du moral, il faut aller voir Cendrillon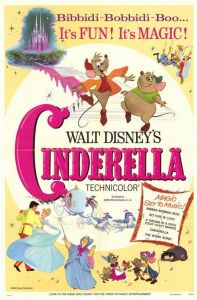 …
…
Que dire alors du sort réservé à l'ange Michael Clarke Duncan dans La ligne verte
dans La ligne verte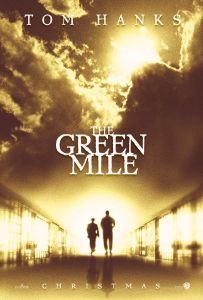 …
…
 on peut déplorer que le grand Fincher
on peut déplorer que le grand Fincher ne se soit pas trop foulé pour nous pondre ce Panic Room.
ne se soit pas trop foulé pour nous pondre ce Panic Room. On était clairement en droit d'attendre mieux de sa part. En effet, même si il constitue une œuvre que l'on retiendra, Panic Room
On était clairement en droit d'attendre mieux de sa part. En effet, même si il constitue une œuvre que l'on retiendra, Panic Room est loin d'être un grand film. Ce qui ne l'empêche pas de nous captiver par instants. Juste par instants. Si l'idée de départ est bonne, le gros du film n'est pas franchement génial et les rares rebondissements manquent d'impact pour nous tenir en haleine jusqu'à la fin. Par contre, Gaulhenrix est dans le vrai : un générique formidable : Les multiples plans aériens de New York – plans fixes d'abord, puis lents travellings, plongées, contre plongées et vues en perspective se succèdent et suscitent le vertige – semblent le fait d'une entité supérieure qui scrute en tous sens cette ville réduite à ses buildings, cependant que l'activité humaine, écrasée au fond de véritables puits de béton et de verre, apparaît pour ce qu'elle est, canalisée, ordonnée et dérisoire. . Joliment dit, Monsieur …
est loin d'être un grand film. Ce qui ne l'empêche pas de nous captiver par instants. Juste par instants. Si l'idée de départ est bonne, le gros du film n'est pas franchement génial et les rares rebondissements manquent d'impact pour nous tenir en haleine jusqu'à la fin. Par contre, Gaulhenrix est dans le vrai : un générique formidable : Les multiples plans aériens de New York – plans fixes d'abord, puis lents travellings, plongées, contre plongées et vues en perspective se succèdent et suscitent le vertige – semblent le fait d'une entité supérieure qui scrute en tous sens cette ville réduite à ses buildings, cependant que l'activité humaine, écrasée au fond de véritables puits de béton et de verre, apparaît pour ce qu'elle est, canalisée, ordonnée et dérisoire. . Joliment dit, Monsieur …
Donc, côté scénario, une bonne idée de base prometteuse mais celle-ci n'a pas été développée pour donner un ressort intéressant tout du long. Heureusement, le casting est lui réussi, au moins pour les acteurs connus. En effet, Jodie Foster qui a très joliment pris dix ans depuis Le silence des agneaux
qui a très joliment pris dix ans depuis Le silence des agneaux est particulièrement convaincante en mère de famille prête à tout pour protéger sa fille. Et pour pallier à la claustrophobie ambiante et là je rejoins PM Jarriq, Fincher
est particulièrement convaincante en mère de famille prête à tout pour protéger sa fille. Et pour pallier à la claustrophobie ambiante et là je rejoins PM Jarriq, Fincher en a fait une image très sexy, le décolleté plongeant et la lippe humide. De plus, la jeune Kristen Stewart,
en a fait une image très sexy, le décolleté plongeant et la lippe humide. De plus, la jeune Kristen Stewart, sa fille dans le film, a été fort bien castée pour ce rôle. Sans dire qu'elle ressemble franchement à sa mère, elle tient formidablement bien la distance. Quant à Forest Whitaker,
sa fille dans le film, a été fort bien castée pour ce rôle. Sans dire qu'elle ressemble franchement à sa mère, elle tient formidablement bien la distance. Quant à Forest Whitaker, même si il est encore dans son rôle habituel de méchant au grand cœur, cela fonctionne malgré tout. Néanmoins, nous l'aurions préféré un peu moins "bonhomme". D’autant que ses deux complices ont tendance à en faire un peu trop, frisant même le comique par moments. Lui est trop sage…
même si il est encore dans son rôle habituel de méchant au grand cœur, cela fonctionne malgré tout. Néanmoins, nous l'aurions préféré un peu moins "bonhomme". D’autant que ses deux complices ont tendance à en faire un peu trop, frisant même le comique par moments. Lui est trop sage…
 qui sauve un peu le truc. En effet, celui-ci, grâce à son errance inspirée parvient à dynamiser son film qui reste donc un peu plat quand même. On pourrait arguer du fait que c’est un huis-clos et que ceci explique cela mais un certain Duvivier
qui sauve un peu le truc. En effet, celui-ci, grâce à son errance inspirée parvient à dynamiser son film qui reste donc un peu plat quand même. On pourrait arguer du fait que c’est un huis-clos et que ceci explique cela mais un certain Duvivier nous a prouvé avec Marie-Octobre
nous a prouvé avec Marie-Octobre que les huis-clos pouvaient se montrer grandioses. Mais les mouvements de caméra originaux de Fincher
que les huis-clos pouvaient se montrer grandioses. Mais les mouvements de caméra originaux de Fincher donnent une certaine âme à cette maison et en font presque un personnage à part entière dans le film. On peut même susurrer que c'est la véritable vedette de cette œuvre. J’ai rarement vu une caméra aussi virevoltante au point de passer à travers les trous de serrure, l’anse et la cafetière et même s’introduire dans un mini conduite de gaz. Réalisation inventive qui nous renvoie souvent à celle de Stephen Hopkins
donnent une certaine âme à cette maison et en font presque un personnage à part entière dans le film. On peut même susurrer que c'est la véritable vedette de cette œuvre. J’ai rarement vu une caméra aussi virevoltante au point de passer à travers les trous de serrure, l’anse et la cafetière et même s’introduire dans un mini conduite de gaz. Réalisation inventive qui nous renvoie souvent à celle de Stephen Hopkins pour son excellent Blown Away.
pour son excellent Blown Away.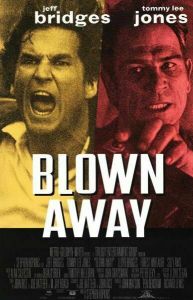 En fait, le problème ne vient pas de l'ambiance ni de la réalisation mais du scénario qui, décidément, à part l'idée de départ est trop classique et sans surprises pour que le film soit vraiment bon. Au final, une entreprise un peu décevante mais qui nous offre quand même sa part de frissons. On peut comprendre que les avis divergent…
En fait, le problème ne vient pas de l'ambiance ni de la réalisation mais du scénario qui, décidément, à part l'idée de départ est trop classique et sans surprises pour que le film soit vraiment bon. Au final, une entreprise un peu décevante mais qui nous offre quand même sa part de frissons. On peut comprendre que les avis divergent… confirme, et au delà !, ce que je viens d'écrire. Voilà un réalisateur, David Fincher,
confirme, et au delà !, ce que je viens d'écrire. Voilà un réalisateur, David Fincher, dont le talent de mise en scène n'est pas contestable et qui, comme c'est amplement démontré, possède même une réelle virtuosité et une grande élégance pour vous présenter un cadre, un décor, une situation. Voilà une bizarrerie intéressante (dont j'avoue n'avoir jamais entendu parler jusqu'à la vision du film), la chambre préservée, la pièce de sûreté, construite pour protéger de riches habitants contre les intrusions crapuleuses et dangereuses. Une distribution intelligente, dominée par Jodie Foster,
dont le talent de mise en scène n'est pas contestable et qui, comme c'est amplement démontré, possède même une réelle virtuosité et une grande élégance pour vous présenter un cadre, un décor, une situation. Voilà une bizarrerie intéressante (dont j'avoue n'avoir jamais entendu parler jusqu'à la vision du film), la chambre préservée, la pièce de sûreté, construite pour protéger de riches habitants contre les intrusions crapuleuses et dangereuses. Une distribution intelligente, dominée par Jodie Foster, dans le rôle de Meg Altman, dont la dureté de visage donne conscience de la détermination, de Kristen Stewart,
dans le rôle de Meg Altman, dont la dureté de visage donne conscience de la détermination, de Kristen Stewart, sa fille Sarah, diabétique et Forest Whitaker,
sa fille Sarah, diabétique et Forest Whitaker, Burnham, le (un peu trop) brave type poussé par les duretés de la vie et les nécessités de la survie à devenir cambrioleur.
Seulement, lorsque les deux oiselles se sont enfermées solidement dans leur château-fort, à quoi doivent absolument accéder les cambrioleurs, qu'est-ce qu'on fait, d'autant qu'on n'en est sans doute qu'à la fin des premières trente minutes d'un film qui compte presque deux heures ? On va multiplier les fausses espérances, comme la tentative d'alerter un voisin somnolent par un jeu de lumières en langage Morse, on va introduire des éléments de suspense forts, comme la tentative d'asphyxie au gaz des deux femmes qui va se retourner contre ses instigateurs, on va ajouter tout ce qui, dans un film de suspense, sait maintenir l'attention du spectateur, comme ce téléphonage à Stephen Altman (Patrick Bauchau)
Burnham, le (un peu trop) brave type poussé par les duretés de la vie et les nécessités de la survie à devenir cambrioleur.
Seulement, lorsque les deux oiselles se sont enfermées solidement dans leur château-fort, à quoi doivent absolument accéder les cambrioleurs, qu'est-ce qu'on fait, d'autant qu'on n'en est sans doute qu'à la fin des premières trente minutes d'un film qui compte presque deux heures ? On va multiplier les fausses espérances, comme la tentative d'alerter un voisin somnolent par un jeu de lumières en langage Morse, on va introduire des éléments de suspense forts, comme la tentative d'asphyxie au gaz des deux femmes qui va se retourner contre ses instigateurs, on va ajouter tout ce qui, dans un film de suspense, sait maintenir l'attention du spectateur, comme ce téléphonage à Stephen Altman (Patrick Bauchau) , mari séparé et père aimant de Meg et de Sarah, qui avorte après avoir presque réussi…
On renverse tant bien que mal la situation, en éliminant un des voyous, en bousculant les positions des chasseurs/chassés, en instillant une crise de tétanie grave chez la pauvre gamine. Mais il faut bien qu'on tire à la ligne ; un peu (la visite des deux policiers dont l'un flaire manifestement quelque chose), l’arrivée incongrue de l’ex-mari dans le bordel et sa rapide mise hors d’état de nuire. Tant à faire !
, mari séparé et père aimant de Meg et de Sarah, qui avorte après avoir presque réussi…
On renverse tant bien que mal la situation, en éliminant un des voyous, en bousculant les positions des chasseurs/chassés, en instillant une crise de tétanie grave chez la pauvre gamine. Mais il faut bien qu'on tire à la ligne ; un peu (la visite des deux policiers dont l'un flaire manifestement quelque chose), l’arrivée incongrue de l’ex-mari dans le bordel et sa rapide mise hors d’état de nuire. Tant à faire !
Mais la fin, c'est, comme on dit aujourd'hui à la télé, Du grand n'importe quoi et une sorte de folie à la Evil dead où les mourants surgissent toutes griffes dehors alors qu'on les pensait éliminés du paysage et se jettent rageusement sur les miraculés. Et la dernière séquence, irénique et melliflue où, les choses revenues dans leur ordre normal, les deux femmes bavardent dans ce qui doit être Central park est là pour donner à chacun bonne conscience.
où les mourants surgissent toutes griffes dehors alors qu'on les pensait éliminés du paysage et se jettent rageusement sur les miraculés. Et la dernière séquence, irénique et melliflue où, les choses revenues dans leur ordre normal, les deux femmes bavardent dans ce qui doit être Central park est là pour donner à chacun bonne conscience.
On ne peut dire qu'on s'est ennuyé ; on ne peut pas dire que ça ne soit pas là du cinéma de consommation..
Page générée en 0.0087 s. - 5 requêtes effectuées
Si vous souhaitez compléter ou corriger cette page, vous pouvez nous contacter